Lyon, les années Rabelais
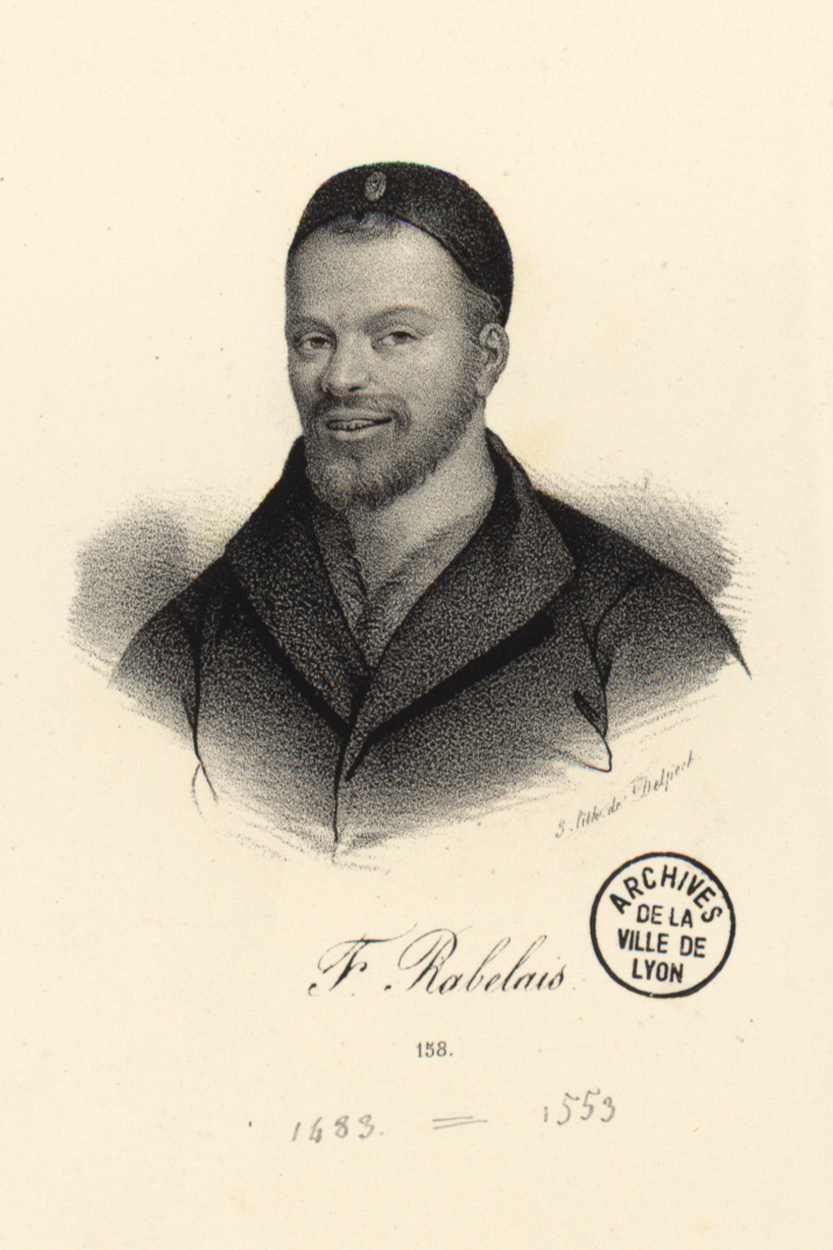
Archives municipales de Lyon / Palais Saint-Jean
Du 3 juin au 31 juillet 1994
Conception
- Jeanne-Marie Dureau
En cette année de commémoration du 500e anniversaire de sa naissance, les Archives Municipales rendent hommage à François Rabelais à travers une exposition consacrée à la ville de Lyon sous la Renaissance telle qu'a pu la connaître et la fréquenter à plusieurs reprises le célèbre auteur de Gargantua et Pantagruel. De la physionomie de la ville à son rôle stratégique dans les ambitions italiennes des rois de France en passant par la vie quotidienne de ses habitants (pauvreté, maladie, foires, festivités, métiers et bouillement intellectuel) jusqu'au développement de la Réforme, cette évocation permet de mieux cerner la première moitié du XVIe siècle entre Rhône et Saône.
On pense en effet que cet écrivain apôtre du rire et de la bonne chère naquit la même année que François 1er, en 1494, sans pour autant que cela soit vraiment confirmé (on parle aussi de 1483 ! ). Cet esprit hors du commun qui s'est intéressé à tous les aspects de la connaissance de son temps suscite encore bien des interprétations. On a coutume de voir en lui le représentant typique de la Renaissance française à une époque où vont s'exprimer les valeurs nouvelles de l'humanisme.
Variété de ses centres d'intérêts et diversité de ses expériences le conduisirent de Montpellier à Metz, de Rome à Meudon, de Chinon à Turin, et dans bien d'autres lieux qui s'honorent de sa présence. Toutefois les liens que Rabelais eut avec Lyon furent particulièrement puissants et nous ne pouvions manquer de nous unir aux célébrations nationales en cette année d'anniversaire.
" Ignorer Lyon et Rabelais, ce serait ignorer deux merveilles de l'univers "
écrivait Jean Boysonné, poète et ami de Rabelais.
C'est à Lyon que Rabelais devint celui que l'on sait : il y commence sa carrière médicale et ce avant même d'avoir terminé ses études, puisqu'il ne sera reçu docteur, à Montpellier, qu'en 1537 ; d'autre part, profitant de la relative liberté de pensée et d'expression qui règne à Lyon, il inaugure la diffusion de ses oeuvres sur les presses de la rue Mercière. S'il n'occupa sa charge à l'Hôtel-Dieu que pendant un peu plus de deux ans (novembre 1532 à février 1535), par contre ses liens avec le milieu intellectuel et éditorial ont perduré pendant seize ans, donnant lieu à des séjours plus ou moins longs. En 1532, il publie chez Claude Nourry son Pantagruel et édite, de 1532 à 1548, ses autres oeuvres médicales, humanistes, érudites, romanesques et ses prédictions et almanachs de fantaisies.
Les Archives Municipales ayant la chance de conserver les seules traces connues de l'activité de Rabelais à l'Hôtel-Dieu, se devait de le célébrer plus que toutes autres institutions. Pour éclairer ces pièces capitales certes, mais peu nombreuses (trois registres au total), c'est tout le contexte que connut Rabelais qu'évoque l'exposition proposée. Son activité littéraire est représentée par quatre ouvrages précieux : des premières éditions lyonnaises, qui, faute d'être conservées à Lyon, viennent pour l'occasion de Beaune, Grenoble et Toulouse.
Par ailleurs tout le cadre dans lequel a vécu Rabelais est rendu présent par un certain nombre de pièces d'archives que viennent animer des ouvrages originaux, des miniatures, une maquette de la ville en 1550, des mannequins costumés, des instruments médicaux, des pièces archéologiques, des objets usuels de la vie quotidienne.
Ainsi, le bâti est-il représenté pour partie grâce au plan scénographique de 1550, le plus ancien plan connu de Lyon. Conservé et restauré par les Archives Municipales, il a servi de support à la réalisation d'une maquette de la ville en liège, bois et carton. Des vues macrophotographiques en ont été tirées et dépeignent sous un jour nouveau les fortifications de la ville, les ponts, les édifices religieux parmi lesquels, entre autres, la cathédrale Saint-Jean, les églises Saint-Georges, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Paul, Saint-Nizier, Saint-Bonaventure et N.-D. de Confort ainsi que les bâtiments privés de la ville et divers personnages en situation. Le Lyon du temps de Rabelais est alors en pleine mutation.
Grâce aux matériels archéologiques exposés provenant de l'emplacement de l'Hôtel Dieu et de l'îlot Tramassac, le visiteur se fera une idée des pratiques culinaires et de la vie quotidienne des habitants par ailleurs affligés de bien des malheurs. La peste de 1530 et la disette de 1531 consécutives à plusieurs années de sécheresse, suivent la révolte frumentaire de 1529. La pauvreté ne touche pas moins de 8.000 personnes et les formes traditionnelles de charité ne suffisent plus ; c'est la création de "l'Aumône générale" dont la gestion est confiée à des recteurs recrutés dans l'aristocratie marchande. Avec la fréquentation de ses quatre foires annuelles, et de par l'importance de son commerce et de sa situation non loin de Genève, on assiste, à partir de 1524, aux premiers ferments d'une agitation religieuse qui témoigne des progrès des idées réformatrices à Lyon. Ville carrefour où se conjuguent les influences germaniques et italiennes dans le domaine des arts, et centre brillant de la pensée, Lyon est prospère et son rayonnement, indéniable. Rabelais y fréquente des lettrés et des intellectuels tels que Henri Corneille Agrippa, le poète Clément Marot, Bonaventure des Périers, Maurice Scève et Louise Labé, le médecin humaniste Symphorien Champier, sans oublier le célèbre Nostradamus qui fut son compagnon d'études à Montpellier et qu'il retrouva par la suite dans "la ville des deux fleuves".
En 1530, on peut estimer à environ 40.000 le nombre des lyonnais, ceci sans aucune certitude faute de registes paroissiaux avant 1539. On soulignera donc l'originalité du registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Pierre-le-Vieux (1532-1545) qu'édite dans le catalogue Jeanne-Marie Dureau, archiviste de la ville.
Le fonctionnement des institutions, de la milice des pennonages, ou encore la défense de la ville par les "joueurs de l'arquebuse", réquisitionnés par le Consulat pour réprimer les agitations populaires, les relations avec le pouvoir royal et les fêtes somptueuses dans les rues tendues de tapisseries lors des entrées triomphales du roi en 1507 et 1515 et de la reine Eléonore en 1533 font partie des thèmes également abordés dans l'exposition "Lyon, les années Rabelais".







